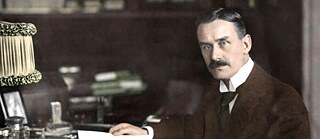Pourquoi Thomas Mann compte-t-il encore aujourd'hui parmi les plus importants romanciers de langue allemande du 20e siècle ? Pourquoi ses romans et ses nouvelles sont-ils toujours lus, traduits dans le monde entier, portés à la scène et adaptés au cinéma ? Pourquoi s’en inspire-t-on encore pour créer des œuvres littéraires ? Qu'est-ce qui les rend compatibles avec notre époque ?
Avec son premier roman Les Buddenbrook, le déclin d'une famille, paru en 1901, Thomas Mann réussit à écrire une saga familiale turbulente sur quatre générations, roman pour lequel il reçut le prix Nobel en 1929 - et qui sert encore aujourd'hui de modèle pour les chroniques familiales contemporaines.Histoires de famille
Ce roman de Thomas Mann raconte l'ascension et la chute d'une famille de commerçants du nord de l'Allemagne au 19e siècle, la dureté et l'audace croissantes des pratiques commerciales, la politique matrimoniale de la famille marquée par des considérations économiques, la rigueur de l'étiquette dans la grande bourgeoisie et la terreur de la vie scolaire chez le plus jeune de la fratrie. À cela s'opposent des tentatives de fugue, des excès et des symptômes de décadence : des lectures d’ouvrages philosophiques débridés, l'ivresse de la musique, des histoires d'amour obstinées, une faiblesse gastrique nerveuse progressive et un état maladif.À travers les quatre générations des Buddenbrook, on peut lire les changements sociaux, culturels et économiques de leur époque. Comme peu d'autres, ce roman allie la pratique narrative réaliste des romans sociaux du 19e siècle à la psychologie et la Nervenkunst (art des nerfs) de l’époque moderne. L'imbrication rigide des intérêts commerciaux et familiaux semble toujours d'actualité (et se prête à l'adaptation littéraire), et par conséquent la mise en opposition par chaque génération de l'ordre bourgeois et de la sensibilité artistique anarchique, qui refuse le principe de l'économie de marché. Les nombreuses adaptations du roman pour le théâtre contemporain en témoignent.
Au-delà des Buddenbrook, Thomas Mann utilisa l'univers narratif de la famille pour montrer les phénomènes d'érosion du mode de vie bourgeois ou pour évoquer des conflits de famille mythiques : notamment dans la nouvelle intitulée Désordre, parue 1925, dont l’histoire se déroule durant la période d'inflation suivant la Première Guerre mondiale, ou dans l'épique tétralogie romanesque Joseph et ses frères (1933-1943).
Ivresse, désir, trouble de genre
La dynamique interne de nombreux récits et romans de Thomas Mann est liée au motif de la visitation, « de l'irruption de forces destructrices et dévastatrices dans une vie rangée et vouée à tous les espoirs de dignité et de bonheur conditionnel », comme il le décrit en 1940. Le fait qu’une vie ordonnée puisse être si rapidement balayée par des forces destructrices enivrantes présuppose une disposition intérieure des personnes qui subissent ces forces. Elles sont animées par un désir inconscient d'échapper à leur mode de vie insipide, généralement bourgeois.Nombre de ces personnages portent comme un secret de polichinelle ce qui anima l'auteur toute sa vie : la tension entre le désir homosexuel et la vie bourgeoise qu'il s'était choisie en tant que père de six enfants. L'œuvre narrative présente à plusieurs reprises des projets de masculinité qui échouent, mais aussi des constructions identitaires androgynes, bisexuelles et transgenres, telles qu'elles sont incarnées entre autres par l'imposteur Felix Krull. L'éventail des œuvres littéraires dans lesquelles Thomas Mann traite de l'ivresse, du désir et du trouble de genre fait de lui le plus grand psychologue de la sexualité dans la littérature allemande, résume le germaniste et éditeur de Thomas Mann, Hans Rudolf Vaget.
Personnages artistiques, réflexion sur l’art
Peu d'auteur.e.s de l'époque moderne ont traité de modes de vie et d’attitudes artistiques de manière aussi incessante que Thomas Mann. Dès ses premiers récits, son intérêt narratif se porte sur la perception du monde des marginaux stigmatisés, ceux qui se sentent isolés des « gens normaux », ordonnés et comme les autres.Il s'agit d'écrivains, de musiciens, d'artistes visuels, parmi lesquels des décadents et des dilettantes déconnectés de la réalité, de sauvages prêchant la violence (Chez le prophète), mais aussi de citoyens à la dérive comme Tonio Kröger (Tonio Kröger) ou d’auteurs de manuels scolaires renommés comme Gustav von Aschenbach (La mort à Venise), et enfin d’imposteurs (Les Confessions du chevalier d’industrie Felix Krull) et d’hypnotiseurs (Mario et le magicien).
Ils sont tous dotés d'une irritabilité et d'une sensibilité extraordinaires, qui les prédisposent à un sens de l’observation aigu et impitoyable. Et ils servent aussi bien à l'autoréflexion sur leur mode de vie artistique qu'à la confrontation littéraire avec le laboratoire de l’époque moderne, qui propose également des délires malsains, de la séduction et de la démagogie par le biais de l'art.
La narration moderne
Dès le début, l'art narratif de Thomas Mann se modèle aussi bien sur la prose européenne moderne que sur la méthode de composition musicale de Richard Wagner. On peut le constater à travers des leitmotivs significatifs qui traversent et structurent l’un de ses premiers récits, Le petit monsieur Friedemann (1897).La magie relationnelle de sa prose s'accompagne en outre d'une forme très particulière de montage de citations. Un premier exemple marquant en est la reprise presque mot pour mot de l'article « Typhus » du Meyers Konversationslexikon (traduction littérale: Grand lexique de conversation de Meyer) pour décrire la maladie mortelle du jeune Hanno Buddenbrook. Ces citations et d'autres provenant de sources totalement hétérogènes s'intègrent si étroitement au contexte narré que les points de rupture sont à peine visibles. Rétrospectivement, Thomas Mann appela ce procédé « recopiage supérieur » - ce procédé est remis au goût du jour en cette période dite post-moderne. Thomas Mann réagissait de cette manière à l'ébranlement spécifiquement moderne des certitudes traditionnelles avec une ironie narrative. Ainsi, les points de vue contradictoires pouvaient être maintenus en suspens, tandis que les convictions unanimes ou obstinées pouvaient être démasquées de manière ludique.
Dans son roman La montagne magique (1924), Thomas Mann opposa à l'accélération générale (que l'on ressent encore aujourd'hui) un ralentissement narratif radical de la perception du temps, lequel se saisit notamment de Hans Castorp, un jeune homme épuisé par ses études, qui ressent les sept années passées au sanatorium « Berghof » de Davos comme un séjour d’une journée seulement. Ce ralentissement irradie à la fois sur les lectrices et lecteurs du roman. Par la défabulation, la décélération et l'encyclopédisation, ce roman pulvérise l'idée d'action et d'intrigue : une réponse aussi risquée qu'innovante à la crise du récit, virulente dans les années 1920.
Littérature et politique
« L'Amérique sent elle aussi que la démocratie n'est plus aujourd'hui une valeur sûre, qu'elle est contestée, gravement menacée de l'intérieur comme de l'extérieur, qu'elle est redevenue un problème. Elle sent que l'heure est venue pour la démocratie de réfléchir sur elle-même, de se souvenir, de faire le point et d'effectuer une prise de conscience - en un mot, de se renouveler dans les pensées et les sentiments », déclare Thomas Mann en 1938 lors de sa tournée de conférences aux Etats-Unis : un constat d'une actualité déconcertante.À cette époque, il avait depuis longtemps laissé derrière lui les Considérations d’un apolitique (tout à fait réactionnaires), parues en 1918 et provoquées par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Dès 1922, date à laquelle il se déclara publiquement en faveur de la République, Thomas Mann ne cessa de mettre en garde à haute voix contre le mouvement national-socialiste, et en 1933, il prit immédiatement le chemin de l'exil avec sa famille. Au cours de ces années, son œuvre littéraire fut également teintée par la politique.
Sous l'influence de la guerre mondiale, de la révolution de 1918, de la République des Conseils de Bavière et des premières années de crise de la République de Weimar, le roman La montagne magique s'articule au début autour de la terreur, de la révolution, de l'ordre étatique ou de l'anarchie, de la valeur du travail et des problèmes du progrès, c'est-à-dire de questions politiques toujours actuelles. « Thomas Mann ne vit pas, comme certains le pensent, dans l'isolement de La montagne magique de ses rêves. Au contraire, il révèle ici qu’il absorbe de manière intense, mais non insistante, le sort immédiat de l'humanité », pouvait-on lire dans l'American Hebrew and Jewish Tribune en septembre 1932.
En témoignent des nouvelles comme Mario et le magicien (1930) et La Loi (1943), la tétralogie Joseph et ses frères (1933-1943) et le roman inspiré de Goethe, Charlotte à Weimar (1939). Toutes ces œuvres font clairement allusion aux dangers politiques du fascisme. C'est dans le roman Le Docteur Faustus, paru en 1947, que la confrontation littéraire de Thomas Mann avec le national-socialisme atteint son apogée : ce thème se distingue nettement de ceux abordés dans la littérature des premières années de l’après-guerre, et en ce sens il exige trop des lectrices et lecteurs allemands de cette époque.
Thomas Mann Daily
C'est au plus tard dans les années 1920 que s’établit l'image de Thomas Mann en tant que grand écrivain, issu de la grande bourgeoisie et distant, image alimentée entre autres par des collègues rivaux : Bertolt Brecht parlait de son « col montant », Alfred Döblin de son « pli de pantalon comme principe artistique ». La publication en 1975 de ses journaux intimes mit en lumière de tout autres aspects de sa personnalité : l’évocation ouverte et sans protection de ses désirs homosexuels et de sa condition physique, sa consommation de médicaments, sa lassitude et le doute de soi, ses sentiments d’irritation envers les membres de sa famille, les amis, les étrangers, les escapades de son caniche - le tout relié directement à ses opinions sur l'actualité politique mondiale et à l’angoisse due à sa situation d’auteur en exil.La popularité du compte Twitter @DailyMann montre que la perception publique de Thomas Mann a sensiblement changé : à partir d'avril 2022 et pendant un an, Felix Lindner a publié chaque jour une courte citation tirée des journaux intimes de Thomas Mann. Des entrées comme celles du 20 juillet 1934 (« J'ai recommencé à faire un peu de gymnastique, nu, le matin ») ou du 10 août 1948 (« Grande répugnance à faire quoi que ce soit l'après-midi ») ont contribué à éroder l'image de l'écrivain inaccessible. Plus de 30 000 lectrices et lecteurs ont suivi ces publications.
Ces dernières années, des recherches ont porté sur la vie publique des membres de la famille Mann et les traces qu’ils ont laissées en tant qu’auteurs, que ce soit collectivement ou concurremment. Le premier point de référence important de Thomas Mann est la relation tendue qu’il entretenait avec son frère aîné Heinrich. Dans les années 1920, Klaus et Erika Mann firent une entrée assez bruyante dans le monde de la littérature ; en exil, toute la famille formait une sorte de groupe de réflexion sur les questions politiques. En 1936, Klaus Mann notait déjà dans son journal : « Quelle étrange famille nous sommes ! Plus tard, on écrira des livres sur nous - et pas seulement sur certains d'entre nous ». Cela s'explique sans doute par le fait que les Mann accompagnèrent la période politiquement turbulente de leur vie, celle de l'Empire, de la République de Weimar, de l'exil et de l'après-guerre, en tant que public intellectuals.
Histoire des médias, histoires de médias
Comme peu d'autres auteurs de sa génération, Thomas Mann testa, utilisa et réfléchit aux nouveaux médias de l'époque moderne. Le début des années 1920 vit la première adaptation cinématographique des Buddenbrook ; peu après, il y eut les premiers enregistrements radiophoniques des textes de Mann. En janvier 1929, il participa au premier enregistrement audiovisuel d'un écrivain allemand, et en décembre 1929 fut diffusée en direct la cérémonie de remise du prix Nobel, un reportage qui entra dans la légende.La présence de Thomas Mann dans la vie publique permet de retracer l'histoire turbulente des médias durant la République de Weimar. Cette présence dans les médias se poursuivit lors de son exil aux États-Unis, où il était considéré comme « Hitler's Most Intimate Enemy ». Entre 1940 et 1945, il enregistra à New York et à Los Angeles 55 discours radiophoniques diffusés par la BBC et destinés à inciter les auditrices et auditeurs allemands à résister au régime national-socialiste.
Au-delà des éditions gérées par la maison d’édition S. Fischer et des innombrables traductions, on retrouve l'œuvre littéraire de Thomas Mann dans des formats, des adaptations et des médias très différents. Ses romans (même la tétralogie de plus de 1 800 pages Joseph et ses frères) ont été plusieurs fois portés à la scène, il existe des adaptations pour le ballet et l'opéra, des bandes dessinées, des versions Twitter de certains textes, des romans graphiques, et surtout de nombreuses adaptations cinématographiques. Nombre de ses romans et récits sont devenus des classiques de l’époque contemporaine et ont pu rejoindre ainsi un large lectorat.
La lauréate polonaise du prix Nobel de littérature Olga Tokarczuk a utilisé La montagne magique de Thomas Mann comme toile de fond pour son roman Empuzjon (en français : Le Banquet des Empouses), paru en 2022. Heinz Strunk publiera en novembre 2024, exactement 100 ans après la parution de l'original, un roman intitulé Zauberberg 2.0 (traduction littérale : Montagne magique 2.0). Les histoires de Thomas Mann n'ont visiblement pas fini d'être racontées.
Livres
Les titres suivants sur Thomas Mann, sa vie et son œuvre sont recommandés par Friedhelm Marx, spécialiste de la littérature et de Thomas Mann.
Thomas Mann Handbuch: Leben – Werk – Wirkung (traduction littérale: Manuel sur Thomas Mann: vie – oeuvre – effet) Directeurs de publication: Andreas Blödorn et Friedhelm Marx. Deuxième édition élargie. Stuttgart, 2024.
Thomas Mann Handbuch: Leben – Werk – Wirkung (traduction littérale: Manuel sur Thomas Mann: vie – oeuvre – effet) Directeurs de publication: Andreas Blödorn et Friedhelm Marx. Deuxième édition élargie. Stuttgart, 2024.
« Ce manuel contient des articles sur tous les romans et récits de Thomas Mann, sur ses essais les plus importants, les motifs significatifs, les références et les contextes : pour consulter, découvrir, continuer à lire... »
Hermann Kurzke: Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk (traduction littérale: Thomas Mann. La vie en tant qu’oeuvre d’art). Munich, 2001.
« La meilleure biographie de Thomas Mann, dans la mesure où elle entremêle sa vie et son œuvre. »
Colm Tóibín: Le Magicien. Roman. Traduit de l’anglais par Anna Gibson. Paris, 2022. (Original: The Magician. A Novel. New York, 2021).
« Un roman qui raconte la vie de Thomas Mann et de sa famille avec plus de liberté et d'empathie qu'une biographie ne pourrait le faire. Le récit des années américaines est particulièrement fort. »
Tobias Boes: Thomas Mann's War: Literature, Politics, and the World Republic of Letters. Ithaka et Londres, 2019.
« Une brillante étude de sociologie littéraire sur le succès de Thomas Mann lors de son exil aux États-Unis. »
Hans Vaget: Seelenzauber. Thomas Mann und die Musik (traduction littérale: Un magicien de l’âme. Thomas Mann et la musique) Francfort sur le Main, 2011.
« Le livre le plus important sur la relation que Thomas Mann a entretenu toute sa vie avec la musique, en particulier avec l’œuvre du compositeur Richard Wagner. »
Magdalena Adomeit, Friedhelm Marx et Julian Voloy: Thomas Mann 1949. Rückkehr in eine fremde Heimat (traduction littérale: Thomas Mann 1949. Retour dans un pays natal étranger) Roman graphique. Munich 2025.
« Ce roman graphique raconte le spectaculaire voyage transfrontalier en Allemagne de Thomas Mann en 1949, qui l'a conduit à la fois à Francfort et à Weimar : un événement médiatique politique du début de l'histoire de l'après-guerre ».
Liens sur le thème
Mars 2025